| |
Préparé par le professeur Moha Ennaji
(chercheur universitaire), ce collectif de 166 pages
vient d’être publié par l’Institut Royal de la Culture
Amazighe. Il comprend un ensemble d’articles motivés par
l’intérêt grandissant pour les études de la culture
populaire face à la mondialisation.
Les articles traitent de questions liées à l'oralité, notamment la
poésie, la chanson, le raï, le conte, le cinéma, les
langues, etc. Le but essentiel de ce collectif est de
poser la problématique du rapport entre la culure
populaire et la culure savante et de soulever des
questions relatives aux cultures populaires au Maghreb
et leur impact sur les domaines sociaux, politiques, et
éducatifs.
Le collectif est également une occasion de présenter des
potentialités créatives qui ont marqué et qui continuent
de marquer de leur empreinte la culture maghrébine en
général et la culture amazighe en particulier. C’est
dans cette perspective que le collectif rend un vibrant
hommage au grand peintre, poète et écrivain nationaliste
M. Mahjoubi Aherdan pour toutes ses contributions à
l’art et à la culture amazighs.
Ainsi, Fatema Mernissi a dressé un portrait artistique de M
Mahjoubi Aherdan, l’homme politique et l’artiste qui
exprime librement ses émotions et ses pensées, san obéir
à aucune censure. Pour Mernissi, Aherdane constitue un
modèle a suivre par les jeunes à cause de sa confiance
en soi et sa capacité extraordinaire de créativité.
Par ailleurs, Moha Ennaji a indiqué que le Maroc a pour la première
fois dans son histoire reconnu officiellement sa
dimension amazighe. Depuis la création de l’Institut
Royal de la Culture Amazighe, la langue amazighe ne sera
plus limitée aux confins du foyer, des amis intimes, et
aux régions rurales surtout après son introduction dans
le système éducatif.
Mustapha El Adak (INALCO, Paris) a discuté de l’évolution de la
chanson rifaine. Il a indiqué que telle qu'elle se
pratique aujourd'hui, la chanson populaire rifaine
brasse en elle des harmonies, des rythmes et des timbres
de voix empruntés directement ou inspirés de plusieurs
musiques aussi bien nationales qu'internationales.
« Pathos et anthropos dans la poésie amazighe » est le titre de la
communication de Bassou Hamri (Faculté des Lettres de
Béni Mellal). L’intervenant a montré que la poésie
amazighe, en tant que produit littéraire oral, et donc
culturel, fournit un apport anthropologique et
psychologique du milieu où elle s’élabore et où se
trouvent posés avec acuité les problèmes de la valeur
esthétique, intimement liés à l’évolution culturelle.
De sa part, Ali Fertahi (Faculté des Lettres de Béni Mellal) a
débattu de la réalité imaginaire dans la poésie du Moyen
Atlas. Il a indiqué que la poésie amazighe du Moyen
Atlas est le reflet d’une réalité, visible ou invisible.
Le rapport au réel dépend des courants littéraires, des
modes certes, mais encore des conceptions purement
personnelles que se font certains artistes de leur art.
Fouad Saa (Faculté des Lettres Saiss, Fès) a discuté du thème "La
poésie amazighe au service du développement culturel à
Figuig". Pour lui, la poésie est un vecteur de la
cohésion sociale et le reflet de l’attachement aux
valeurs humaines et locales de la communauté.
Mohamed Djellaoui (Université de Tizi Ouzou) a dressé un tableau
sur les spécificités de la poésie amazighe en Algérie,
poésie selon lui, qui se caractérise par sa beauté, son
symbolisme, et son réalisme. Cette poésie kabyle reflète
vivement la vie quotidienne et sociale de la communauté.
D’autre part, Fatima Sadiqi (chercheure universitaire, Fès) a
débattu du rôle des femmes marocaines dans la
préservation de la culture amazighe. Les femmes
marocaines, parlant ou non l’Amazighe, sont les
porteuses par excellence du patrimoine culturel
Amazighe, vieux de plus de 5 000 ans. Elles sont les
principales détentrices d’un héritage qu'elles ont su
préserver et qu'elles continuent de transmettre de
génération en génération.
Hammou Azday (Institut Royal de la Culture Amazighe, Rabat) a
affirmé que la promotion de la culture amazighe et du
développement amazigh est une tradition promise et
transmise, de père en fils, à travers les ères, depuis
la nuit des temps. Cette culture a contribué à la
formation d’hommes, durant des ères, de la méditerranée
jusqu’au de là du fleuve du Niger et du fond de l’océan
Atlantique jusqu'à la rive Ouest du Nil, un potentiel
humain dont le savoir a outrepassé ces frontières.
Nadia Yaqub (University of North Carolina) a discuté de la culture
populaire palestinienne et de son lien étroit avec la
production cinématographique. En se basant sur les films
du producteur palestinien Hany Abu As`ad, elle a mis
l’accent sur les conditions très précaires et inhumaines
dans lesquelles les palestiniens sont forcés de vivre
par l’occupation israélienne. Elle a montré images à
l’appui, l’état de destruction et de désespoir dans les
territoires palestiniens occupés. Malgré cela, le peuple
palestinien continue de lutter pour préserver son
identité et son authenticité culturelle par tous les
moyens.
Habiba Rahim (St. Johns University, New York) a débattu du folklore
et du conte populaire marocain. Vu l’importance de cette
tradition orale et la richesse des thèmes qu’elle aborde
(la justice, la sagesse, l’âge, le genre, l’amitié,
etc.), l’auteur propose l’introduction de cet héritage
riche et varié dans le cursus scolaire et universitaire.
John Shoup (Université Al Akhawayn) a discuté de la
musique contemporaine (Saharan Blues) en Mauritanie, sud
de l’Algérie, Mali, Niger et Sénégal. Cette région est
marquée par un métissage des cultures et ethnicités. La
musique reflète la composition multiculturelle et
multiethnique de cette région.
Maria Angels Roque (Institut Méditerranéen, Barcelone) a débattu du
voyage dans les espaces civiques marocains. Elle a
débattu de la tradition amazighe dans le champ
associatif et la transformation moderne apportée par les
associations notamment dans la région Souss et l’autre
de la Vallée du Draa.
Read and dowload book
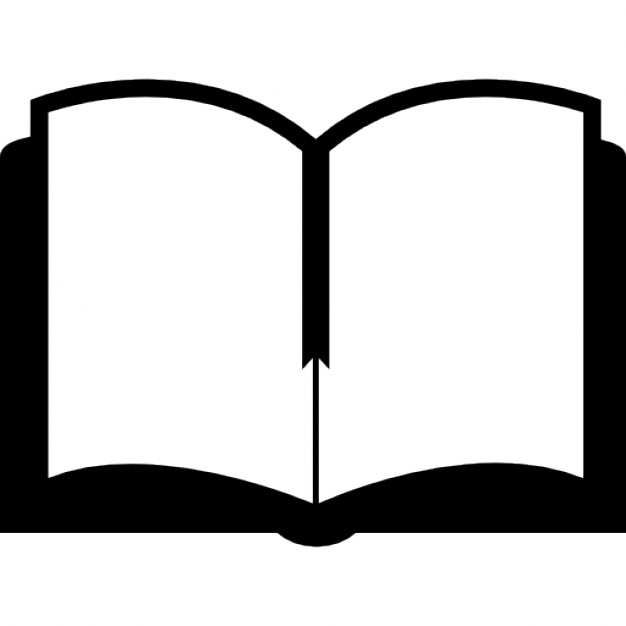
|